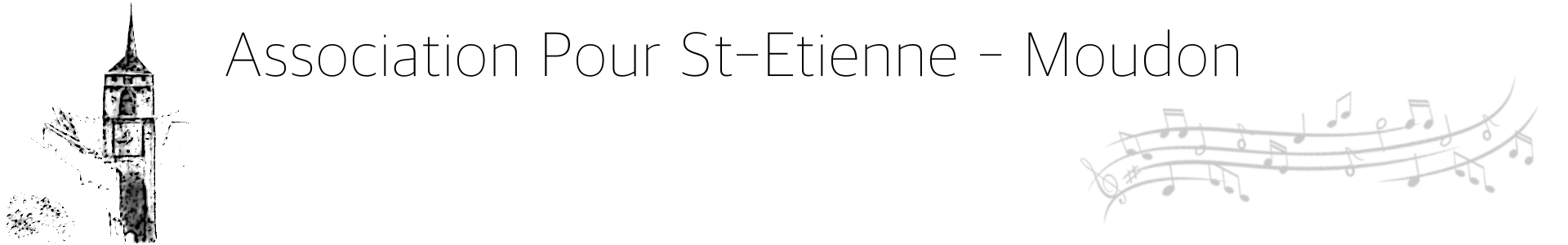Le Temple Saint-Étienne de Moudon
 Choeur In Illo Tempore 18.2.2024
Choeur In Illo Tempore 18.2.2024
Une « Cathédrale de la Broye » aux racines millénaires
Depuis plus de sept siècles, la silhouette gothique du temple Saint-Étienne domine Moudon. Surnommé la « Cathédrale de la Broye », l’édifice s’étire sur 55 mètres, avec des voûtes culminant à 20 mètres, des proportions qui le rapprochent des grandes cathédrales tout en conservant l’échelle d’une église paroissiale. Le site, occupé bien avant l’achèvement de l’église gothique vers 1280, a livré des traces d’un sanctuaire de l’époque gallo-romaine, relayé au XIIe siècle par une église romane. Le lieu manifeste ainsi une continuité cultuelle rare, du monde antique au Moyen Âge central.
Quand la Savoie bâtit son pouvoir
La forme actuelle du sanctuaire s’inscrit dans le contexte savoyard du XIIIe siècle. Pierre II de Savoie, dit le « petit Charlemagne », érige Moudon en centre administratif du Pays de Vaud vers 1260. Dans ce cadre, le programme architectural du temple s’inspire des modèles gothiques en vogue, notamment de la cathédrale de Lausanne dont il reprend certaines lignes dans un format réduit. Le chantier, ouvert vers 1280–1281, dote la ville d’un édifice représentatif de son rôle régional, à la fois sobre et magistral par l’équilibre de ses volumes.
Le saviez-vous ? Conçu sur le modèle lausannois, le temple en adopte l’esprit sans en reproduire l’échelle : une « moitié » de cathédrale qui affirme néanmoins la stature de Moudon dans la Broye.
Un clocher, témoin des défenses et des rites
Élément majeur du paysage urbain, la tour occidentale naît au XIIIe siècle dans une logique défensive et s’intègre aux remparts en 1281. Sa transformation en clocher, conduite entre 1416 et 1436, lui confère la silhouette que l’on connaît. De tour de garde à tour de prière, l’ouvrage concentre l’histoire urbaine et religieuse de la cité.
1536 : la Réforme et la recomposition du sanctuaire
L’année 1536 marque un tournant. L’introduction de la Réforme sous administration bernoise entraîne la suppression des dix-huit autels secondaires et des statues, et réoriente la liturgie. Loin d’un vandalisme généralisé, la période moderne voit au contraire des interventions structurantes : renforcement des contreforts en 1582, puis installation d’une chaire en molasse en 1695, qui accompagne la prédication réformée.
L’orgue Potier (1764) : un patrimoine musical conservé
En 1764, la communauté passe commande au facteur d’orgues français Adrien-Joseph Potier. L’instrument baroque, doté d’un buffet sculpté et de 21 jeux sur deux claviers, constitue aujourd’hui le plus ancien orgue baroque encore jouable du canton de Vaud. Jugé d’abord trop discret, il est rapidement complété par l’ajout d’une Mixture. Plusieurs interventions se succèdent aux XIXe et XXe siècles, avant une restauration d’ampleur menée en 1974 par la manufacture Kuhn (Männedorf), qui restitue son caractère historique.
Note d’atelier : à la réception de l’instrument, une Mixture supplémentaire est demandée pour renforcer la brillance des dessus, signe d’une pratique musicale locale attentive aux équilibres sonores.
Stalles de la fin du Moyen Âge : survivances précieuses
Réalisées entre 1499 et 1502 par Rodolphe Pottu, Peter Vuarser et Mattelin Vuarser, les stalles du chœur relèvent d’un décor d’exception pour une église paroissiale. Le raffinement du répertoire sculpté, à la charnière du gothique tardif et de la première Renaissance, en fait un ensemble remarquable. Leur conservation au-delà de 1536 illustre la complexité des pratiques locales face aux prescriptions iconoclastes.
Vitraux : un parcours de lumière, du XVIe au XXe siècle
Le décor verrier associe des œuvres anciennes et des interventions modernes. Entre 1935 et 1937, Ernest Biéler réalise des verrières aux couleurs soutenues, notamment autour des vertus théologales. De 1951 à 1953, Charles Clément complète le cycle avec des représentations de Saint-Étienne et de figures bibliques. L’ensemble compose une histoire visuelle du lieu, articulant mémoire et création contemporaine.
Grandes campagnes du XXe siècle : préserver la stabilité et l’usage
Au milieu du XXe siècle, des diagnostics alarmants sur la statique de l’édifice conduisent à une campagne de sauvegarde (1949–1974). Des renforcements, notamment en combles, assurent la pérennité de la structure. Les décennies 1970–1980 voient une remise à niveau fonctionnelle (nivellement du sol, chauffage au gaz) et la restauration de l’orgue, symbolisant la volonté de concilier conservation et pratique cultuelle.
Un lieu de culte et de culture
Le temple demeure un espace vivant. L’Association Pour Saint-Étienne propose chaque saison un cycle de concerts qui valorise l’acoustique du vaisseau gothique. Depuis 1997, l’Association des Amis de l’Orgue organise en septembre un programme dédié à l’instrument de 1764. La vie culturelle moudonnoise (Festival des Musiques populaires, Brandons, nombreux concerts) s’y inscrit régulièrement, faisant du site un pôle régional.
Patrimoine reconnu
Classé bien culturel suisse d’importance nationale, le temple Saint-Étienne dépasse l’intérêt local pour s’inscrire dans le patrimoine du pays. Il constitue également une étape de la Via Jacobi, branche helvétique du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, confirmant sa vocation d’accueil à travers les siècles.
Perspectives
Les recherches archéologiques récentes continuent d’éclairer les phases romaine et médiévale du site, tandis que la commune et les partenaires patrimoniaux accompagnent l’entretien et la mise en valeur de l’édifice. Entre mémoire et usages contemporains, le temple poursuit son histoire, fidèle à sa fonction de rassemblement et de transmission.
Dimensions
• Longueur : 55 m
• Largeur : 22 m
• Hauteur sous voûte : 20 m
• Plus grande église paroissiale du canton de Vaud
De l’antique sanctuaire au monument gothique, des réformes religieuses aux restaurations modernes, Saint-Étienne de Moudon témoigne de plus d’un millénaire d’histoire religieuse, artistique et urbaine. La permanence des pierres et la lumière des vitraux, servies par la voix de l’orgue, en font un repère majeur de la Broye et du patrimoine suisse.
Sources et références
- "Moudon (commune)" - Dictionnaire historique de la Suisse
- "Église St-Étienne de Moudon" - MyVaud
- "Église réformée Saint-Étienne de Moudon" - Wikipedia
- "Cloches - Moudon église réformée Saint-Etienne" - Quasimodo sonneur de cloches
- "Moudon, église réformée Saint-Etienne" - Répertoire des orgues
- "Orgue" - Association Pour St-Etienne
- "Moudon (orgue du 18ème s.)" - Orgues et Vitraux
- "Lifting délicat pour le temple St-Etienne" - 24 Heures
- "Moudon a un nouveau mur médiéval" - 24 Heures
- "La Maison de Savoie en Pays de Vaud" - nicollier.org
- "Brandons de Moudon" - Site officiel
- "Amis de l'Orgue de Moudon" - Site officiel
- "Activités culturelles" - Commune de Moudon
- "Guides de monuments Suisses SHAS - L'église St-Etienne de Moudon", Gaëtan Cassina et Monique Fontannaz, Société d'Histoire de l'Art en Suisse, Berne 1998. ISBN 3-85782-644-4